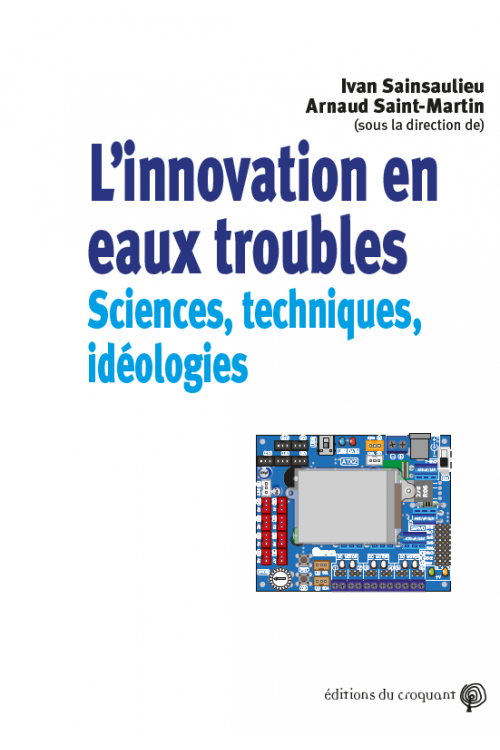Les livres et numéros spéciaux auxquels j’ai participé:
(cliquez sur l’image pour commander le livre)
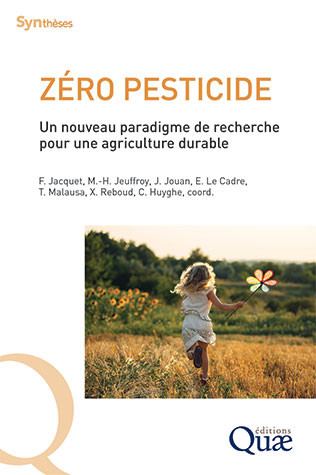 | Vous pouvez le télécharger librement et gratuitement ! Zéro pesticide : un nouveau paradigme de recherche pour une agriculture durable, Jacquet F., Jeuffroy M.-H., Jouan J., Le Cadre E., Malausa T., Reboud X., Huyghe C., Editions Quae, 244p., 2022, 9782759233106 - téléchargeable librement ! La commission de l’Académie Vétérinaire de France a décerné le Prix Jacques DELAGE 2022 à l’ouvrage Zéro pesticide. |
 | Extended Biocontrol, Lannou C., Fauvergue X., Rusch A., Barret M., Jacquin-Joly E., Malausa T. (Eds.), Springer Nature Ed. - pour acheter le livre |
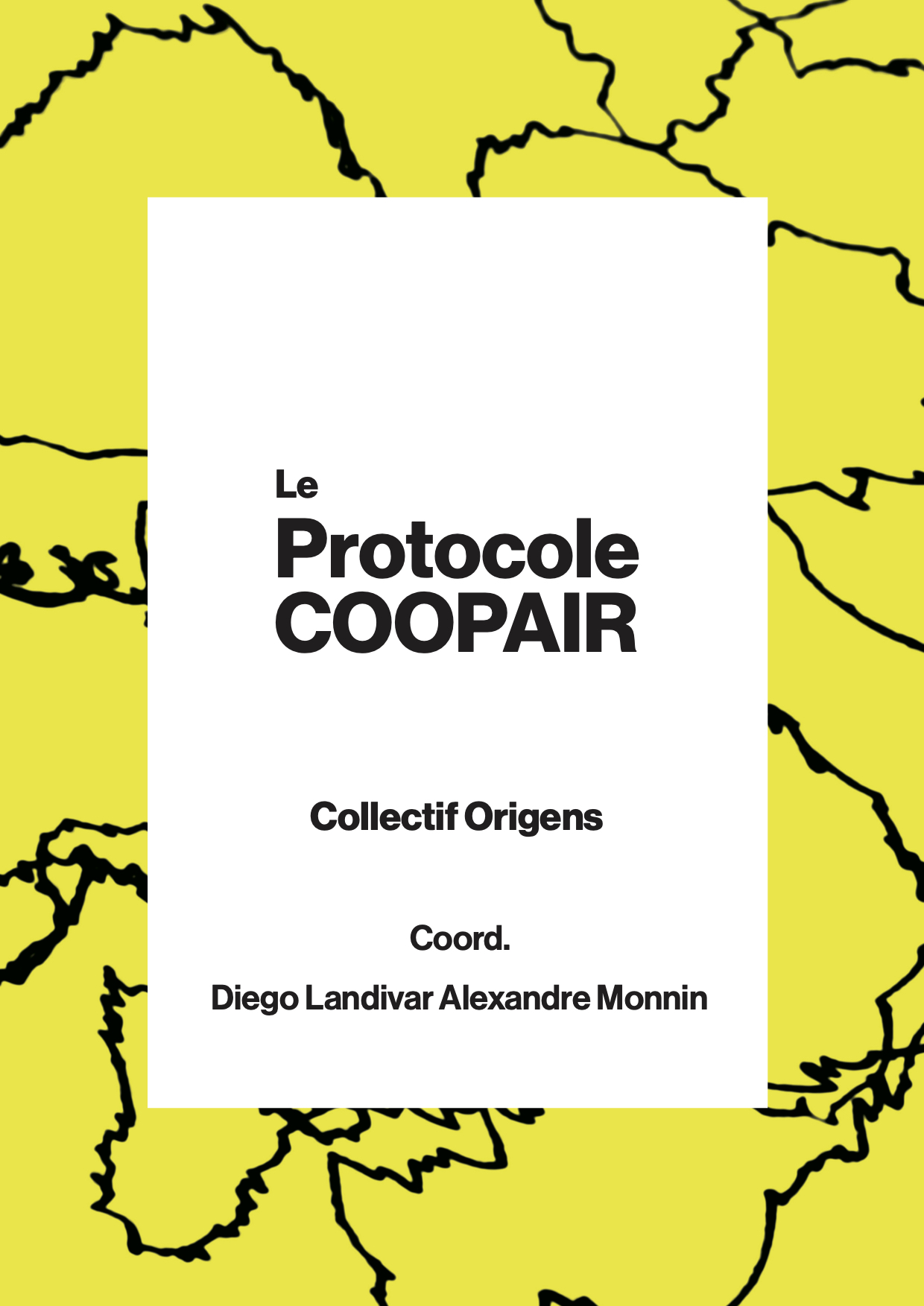 | Vous pouvez le télécharger librement et gratuitement ! Collectif Origens, Landivar D. Monnin A. (2022). Le Protocole Coopair. Editions Open Origens, Clermont-Ferrand, France. - téléchargeable librement ! |
 | Vous pouvez le lire en ligne librement et gratuitement ! La fin du Game ? Les jeux vidéo au quotidien (121p.) Auteur.es : Hovig Ter Minassian, Vincent Berry, Manuel Boutet, Isabel Colón de Carvajal, Samuel Coavoux, David Gerber, Samuel Rufat, Mathieu Triclot, Vinciane Zabban, Presses Universitaires François Rabelais - http://pufr-editions.fr/produit/la-fin-du-game/ |
A. Bidet, C. Datchary, Gérald Gaglio (dir.), 2017, Quand travailler c’est s’organiser. La multi-activité à l’ère numérique, Presses des Mines, Paris, 222p.
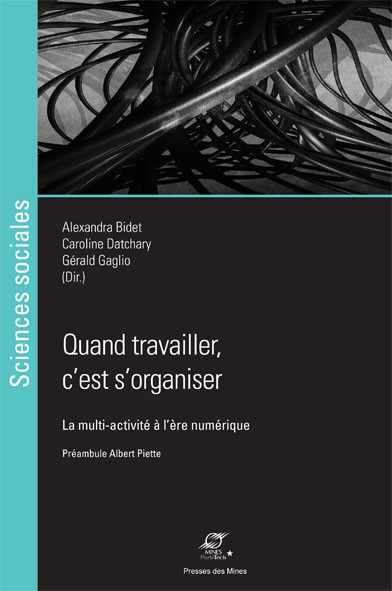 | Une Préface d’Albert Piette, suivie de l’Introduction de l’ouvrage, et de sa table des matières La présentation de l’éditeur : La multi-activité est une caractéristique anthropologique, propre à l’Homme, mais elle devient aussi son défi à l’ère numérique. Quand les espaces de vie et de travail sont de plus en plus riches en écrans, en applications, en messages, en notifications parallèles et simultanées, nous sommes incités à mener plusieurs activités en même temps. Loin des visions idylliques d’un travailleur créatif et flexible ou des dénonciations critiques sur l’intensification du travail, ce livre propose, pour la première fois, une analyse de terrain solide sur l’impact de cette transformation et les formes d’organisation qui en découlent. Appuyé sur un dispositif d’enquête collectif, il examine les compétences mobilisées par le travail en situation de multi-activité dans différents contextes : auprès d’employés et de cadres du privé comme du public, de responsables de communication interne, de médecins de services d’urgence pédiatrique, des techniciens de l’assainissement, etc. Il associe des méthodologies d’enquête et des champs disciplinaires complémentaires : la sociologie, l’anthropologie, les Workplace Studies, l’ethnométhodologie et l’analyse de discours. Ce livre s’adresse aux chercheurs et aux citoyens intéressés par le travail et les technologies de l’information et de la communication, ou souhaitant mieux comprendre comment s’opère au quotidien l’articulation entre de multiples engagements dans un environnement mouvant. |
I. Sainsaulieu, A. Saint-Martin (dir.), 2017, L’innovation en eaux troubles. Sciences, techniques, idéologies, Éditions du Croquant, Vulaine sur Seine, 330p.
M. Grenfell, F. Lebaron (éds.), 2014, Bourdieu and Data Analysis. Methodological Principles and Practice, Peter Lang, 333 pp.
 | La présentation du livre par M. Grenfell et F. Lebarron. Présentation de l’éditeur : Uniquely amongst the numerous publications to appear on the work of the French social theorist Pierre Bourdieu, this book deals with data analysis, examining a range of techniques and instruments. After an introductory chapter outlining the key principles of Bourdieu’s theory, the book presents detailed examples of data being collected and analysed in a Bourdieusian way across various social science contexts. Both quailtative and quantitative methods are addressed, including analysis of the strengths and weaknesses of each method, as are common data collection procedures such as interview, observation and questionnaire. Examples of Multiple Correspondence Analysis are an important feature of the book, since this was an approach particularly favoured by Bourdieu. In each case study, the pros and cons of different approaches are highlighted and the qualitative/quantitative debate is thoroughly explored. Overall, the book offers readers a blueprint to develop their own methodological plans for using Bourdieu in research practice. |
Dawn Stobbart and Monica Evans (eds.), 2014, Engaging with Videogames: Play, Theory and Practice,
 | Introduction by Dawn Stobbart and Monica Evans Overview : Engaging with Videogames focuses on the multiplicity of lenses through which the digital game can be understood, particularly as a cultural artefact, economic product, educational tool, and narrative experience. Game studies remains a highly interdisciplinary field, and as such tends to bring together scholars and researchers from a wide variety of fields and analytical practices. As such, this volume includes explorations of videogames from the fields of literature, visual art, history, classics, film studies, new media studies, phenomenology, education, philosophy, psychology, and the social sciences, as well as game studies, design, and development. The chapters are organised thematically into four sections focusing on educational game practices, videogame cultures, videogame theory, and the practice of critical analysis. Within these chapters are explorations of sexual identity and health, videogame history, slapstick, player mythology and belief systems, gender and racial ideologies, games as a ‘body-without organs,’ and controversial games from Mass Effect 3 to Raid over Moscow. This volume aims to inspire further research in this rapidly evolving and expanding field. |
F. Cochoy, C. Licoppe, 2013, Le sujet et l’action à l’ère numérique, Revue Réseaux, n°182, vol.6, éditions La Découverte.
 | Un compte-rendu de “Le sujet et l’action à l’ère numérique” paru sur lectures. La présentation du numéro par F. Cochoy et C. Licoppe. Présentation du numéro : Avec la multiplication des technologies et des sollicitations informationnelles, la question de la fragmentation de l’attention et des engagements est aujourd’hui devenue un enjeu de débat public. Le sujet est aujourd’hui pensé comme l’agent, voire le gestionnaire d’une multiplicité de tâches ou de liens sociaux qui se croisent dans l’ici et maintenant. Le sujet de l’action devient fragmenté quant à son attention et quant à son engagement, ce qui heurte (et révèle également) des orientations normatives qui privilégient la co-présence physique et l’engagement focalisé comme formes pleines de la présence et l’engagement. Or, tant que nous restons dans ce dernier cadre de pensée, la pluralité située des agents ne peut être vue que sous les figures du manque, du déficit, de la dispersion ou de l’aliénation. Penser cette pluralité suppose au contraire de reposer la question de la présence et l’engagement d’une manière qui ne réduit pas cette pluralité à la vigilance dissociée qui caractérise l’engagement humain dans toute situation, et qui ne la réduit pas non plus à être l’ombre de l’engagement focalisé. Il est intéressant pour cela d’examiner les manières dont nous pouvons en tant que sujets être pris dans une multiplicité de relations à notre environnement, d’une manière qui reste neutre et positive, et dans laquelle se dessine de manière reconnaissable quelques visées ou engagements à la fois différenciés et saillants.. |
A. Rodionoff (dir.), 2013, Les territoires du virtuel. Mondes de synthèse (MMORPG), univers virtuels (Second Life), serious games, sites de rencontre…, Revue MEI, n°37, L’Harmattan, Paris.
 | La présentation du numéro par A. Rodionoff. Présentation de l’éditeur : Au virtuel sont associées de nombreuses significations si bien que celui-ci se dérobe très souvent à l’analyse. Parmi elles, certaines renvoient au domaine de la technique, d’autres tiennent le virtuel pour un concept, d’autres significations enfin se rapportent à l’imaginaire. Le pari et l’ambition de ce numéro ont été de prendre acte de ses diverses significations, une première étape pour déconstruire et circonscrire le virtuel. Une seconde étape nécessaire supposait ensuite de réduire son champ d’application. Aussi, ce numéro rassemble-t-il des analyses de chercheurs qui, in fine, interrogent le virtuel à partir des mondes de synthèse (ou MMOG), des univers virtuels (tels que Second Life), des serious games ou encore des sites de rencontre en ligne. |
E. A. Amato, E. Perenny (eds.), 2013, Les avatars jouables des mondes numériques. Théories, terrains et témoignages de pratiques interactives, Collection “Information, hypermédias et communication”, Hermes Science Publications, Paris.
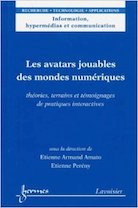 | Préface par Alain Berthoz Introduction par E. A. Amato et E. Perenny Présentation de l’éditeur : Ces créatures d’images polymorphes que sont les avatars jouables nous font exister dans les mondes numériques des jeux vidéo, et même dans certains sites Web communautaires ou ludiques. Parce qu’elles nous y métamorphosent, elles apparaissent emblématiques des pratiques interactives les plus sophistiquées et troublantes. Toutefois, leurs propriétés et effets, espérés ou redoutés, restent encore à éclairer, ainsi que toutes ces interactions à distance réalisées par avatars interposés, au cœur des simulations audiovisuelles informatiques contemporaines. Ancré en sciences de l’information et de la communication, ce premier ouvrage collectif francophone sur le thème conceptualise l’avatar. Aussi, il bénéficie des apports conjugués de différentes disciplines (philosophie des techniques, psychologie, psychanalyse, sémiologie, ethnologie, sociologie, sciences de la gestion, arts). Par cette pluralité et grâce à de constants allers-retours entre théories et terrains, descriptions et analyses, hypothèses et témoignages, peuvent être articulées toutes les dimensions en jeu : technologiques, physiologiques, interpersonnelles, identitaires, intimes et/ou culturelles. |
J.-P. Simon, V. Zabban (dirs.), 2012, Dossier Les formes ludiques du numérique, Revue Réseaux, n°173–174, vol.3/4, éditions La Découverte.
 | La présentation du numéro par K.-P. Simon et V. Zabban Présentation du numéro : Les jeux vidéo apparaissent dans les premiers temps de l’informatique et accompagnent ses développements techniques et sa popularisation. Jeux d’arcade, de salon ou jeux de laboratoire à partir des années 1970, sur les consoles et les ordinateurs personnels au long des années 1980 et 1990 ; en réseau, massifs, multijoueurs et mobiles depuis les dix dernières années. Leurs publics ont grandi avec ces évolutions, et se sont diversifiés au fil des années et de l’élargissement de l’offre vidéoludique. Aujourd’hui, tant sur le plan culturel qu’économique, les jeux vidéo occupent une place centrale dans le secteur des loisirs. La première partie brosse d’abord un état général du marché mondial, en montrant plus particulièrement la place de l’Europe. On trouvera ensuite une étude de l’articulation entre les deux versants de cette industrie (les consoles et les logiciels de jeux), puis des analyses sur des domaines plus spécifiques et plus récents: les jeux en ligne et les jeux sur mobile. L’analyse des pratiques de jeu et des dispositifs ludiques est au centre d’un courant de recherche anglo-saxon, les game studies, encore peu représenté en France. La deuxième partie présentera un bilan de ces recherches, une étude historique sur les premiers jeux des informaticiens universitaires, une analyse des pratiques marginales de triche ou d’arnaque et des analyses ethnographiques. Ces articles ont en commun de travailler la question des relations complexes entre les univers “clos” que sont les jeux et la vie ordinaire. L’accent est ici particulièrement porté sur les appropriations diverses des manières de jouer, et sur les régulations sociales et techniques de ces pratiques hétérogènes. |
H. Ter Minassian, S. Rufat, S. Coavoux (éds.), 2012, Espaces et temps des jeux vidéo, Paris, Editions Questions théoriques, 292 p.
 | Un compte-rendu de “Espaces et temps des jeux vidéo” paru dans GeoCarrefour. L’introduction par H. Ter Minassian et S. Rufat. Présentation de l’éditeur : Explorer les confins de la galaxie, des donjons sinistres ou des pays enchantés, vivre au temps des croisades ou rejouer l’issue de la guere froide, bâtir des villes ou des empires millénaires… au point d’en oublier parfois sa famille, la fatigue ou la faim. Tout jeu vidéo est une invitation au voyage. les jeux vidéo sont des univers dans lequels les joueurs s’immergent, voire s’enferment, pour vivre des aventures hors du temps et de l’espace quotidiens. Cette divergence, cette annulation, vo |